Dans les années
80, fréquenter
une
école ou
un lycée
privés était réservé à ceux qui sortaient des écoles
publiques et
ce type d’enseignement, qui
en était alors à ses débuts, permettait aux
jeunes
de se rattraper pour
réintégrer ultérieurement les établissements
publiques. Cette situation est complètement inversée aujourd’hui et l’enseignement public est
presque réservé pour les tranches
populaires
qui ont des moyens limités et qui ne peuvent pas se payer des écoles privées et qui alors ne peuvent exulter devant les autres
en clamant
que leurs enfants
sont dans telle ou telle école privée de renommée.
Cette stratégie s’est avérée concluante
pour l’état
qui faute
d’arriver à faire payer plus d’impôts à certains
citoyens, est parvenu au moins à se désengager des frais de leur scolarité,
ce qui n’est pas rien. Le problème
qui s’en est
suivi est que l’enseignement public
s’est dégradé,
a perdu en crédibilité
et seuls ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs y restent.
Cette situation a
permis à notre gouvernement de réduire
ses dépenses pour l’enseigne-
ment sans l’avouer et de laisser mourir à petit feux l’école publique
pour laquelle les moyens manquent cruellement
et qui finira sans aucun doute par être délaissée
et devenir comme les dispensaires qu’on trouve ici et là et qui surtout
servent à faire croire que l’état est présent !
Cette situation est difficile à vivre et à défendre,
elle a en effet favorisé l’apparition des heures supplémentaires, très coûteuses pour les parents
et les familles et sans garantie
de succès.
Car imaginons que les moyennes du bac ont atteint des records
aujourd’hui au Maroc et que nos bacheliers avec des mentions Bien
et A. Bien ne trouvent même pas à s’inscrire dans certains établissements à
accès limité et qui jadis étaient fiers quand ils arrachaient des candidats avec une moyenne de 12 au Bac ! Quelle situation et
quel paradoxe ? La situation étant ce qu’elle est, il ne m’appartient pas d’y apporter une
réponse, mais elle
me sert de référence pour le problème que j’essaie de soulever aujourd’hui ; celui de l’enseignement supérieur ! En
effet devant :
– Les difficultés de réformer un système qui montre ses limites,
– Les réticences des syndicats et probablement du corps enseignant,
– Le manque de courage politique
et de visibilité
L’état a choisi une stratégie
identique à celle
de l’enseignement primaire
et
secondaire. Laisser se développer les établissements de l’enseignement supérieur privés, en les
favorisant indirectement par des partenariats public-privés, en les mettant au devant de
la vitrine marocaine et en écartant peu à peu l’enseignement supérieur
public,
qui coûte cher,
qui ne dépend que
des moyens de l’état et qui peine à se frayer un chemin de l’excellence en formation et en
recherche à cause des
moyens limités et du manque de motivation des
intervenants.
Date : 17 septembre 2014.
1
La réalité est que quand
les gens payent,
ce qui se fait en
privé, ils sont en
mesure d’exiger une qualité de formation
et
les établissements qui veulent rester en course sont obligés d’innover tant au niveau formation qu’au niveau de la recherche scientifique.
L’état n’étant pas
en mesure de faire payer les étudiants marocains, il les pousse à aller vers le privé, quitte à brader
parfois la qualité et la renommée
de certaines filières, pour alléger
sa facture et son engagement envers l’enseignement public.
Un exemple concret
peut être donné, celui des classes préparatoires privées, cette idée de filière
de classes préparatoires, nous vient de la France où l’enseignement supérieur est pour partie payant et
où les grandes écoles qui recrutent ces "taupes" sont nombreuses
mais qui n’a aucun
établissement de classes
préparatoires privées !
Au Maroc avec le peu d’écoles
qu’on a, avec les lycées publics
qui font des classes prépa- ratoires aux concours des grandes écoles et qui dispensent des formations respectées et qui rivalisent avec leurs homologues françaises, on a trouvé
le moyen de faire ouvrir des classes préparatoires privées. Cerise sur le gâteau, à certains
de ces jeunes
qui ne réussissent à intégrer
aucune
école, on a pu trouver
un
moyen
de leur garantir une entrée en filières
d’ingénieurs développées dans les facultés
!
En effet le réseau des FST,
croyant réussir l’impossible, se rehausser
au rang des écoles de
renommée, a cru bien faire en instaurant un cota de 20 élèves, qui peuvent intégrer
sans concours les filières d’ingénieurs qui y sont dispensées ! Sachant que ceux qui ont fait leur deux années au sein de l’établissement et tous les autres venant d’autres établissements nationaux passent un concours pour au plus une dizaine de place par filière ! Quel gachis et quel coût d’organisation ! !
C’est
dire
que l’argent pourra faire
de toi un ingénieur
même si le système de sélection ordinaire
a considéré que tu n’avais pas le niveau ! Quelle hypocrisie et Quelle injustice ! Que pouvons nous dire et répondre à ceux qui n’ont pas d’argent et qui viennent en faculté et
triment pour
réussir ? Va–t–on leur dire : "
d’accord
tu
es bon
mais
il faut attendre
que celui qui a payé les classes préparatoires
et qui n’a pas de place choisisse" C’est tout simplement injuste.
Personnellement, je crois qu’il faut
plutôt
dire à ceux qui n’ont eu aucune
école, vous avez choisi les classes préparatoires privées ou publiques,
vous avez choisi la sélection alors continuez
mais nous ne pouvons
vous accorder aucun privilège par rapport aux autres et présentez vous au concours comme vos camarades.
Voilà une décision
juste car l’argent ne
devrait pas aucun
chemin d’accès à quoi que ce soit,
si les compétences ne le permettent pas.
En France les
élèves de classe préparatoires, doivent s’inscrire en faculté
la deuxième
année, pour faire valider leurs
acquis et éviter de se retrouver
sans rien si aucun concours
n’a été réussi. Au Maroc on essaye d’arranger
les
gens et de leur dire aller au privé, on vous trouvera une solution...
Si la solution
se trouve dans la participation aux frais d’inscription,
ce qui se défend tout à fait, il faut l’oser. Il faut en débattre et associer les citoyens à l’instaurer. Il faut expliquer aux gens que quand
on a une université avec 60000 étudiants, il
est difficile de leur garantir
un meilleur accueil
sans une participation minimale chacun selon ses moyens et qui engagera aussi les établissements vis à vis de leurs étudiants pour une qualité
meilleure. Elle permettra
aussi
un
droit
de regard et l’étudiant sera en mesure de
réclamer des
moyens tels que bibliothèque, internet, équipement en TP etc. etc...En
effet nos étudiants payent des sommes incalculables, dans les photocopies des cours,
l’accès à certains
cybers et payent parfois aussi des modems qui marchent tant bien que mal vu la qualité des
réseaux. Il serait
judicieux de leur expliquer que, en payant un
minimum on leur garantira les photocopies, l’accès à Internet illimité et qu’ils seront mieux encadrés dans un environnement plus favorable.
Il est vrai
aussi que notre système est obsolète, il souffre d’une gouvernance pas assez réfléchie, non optimisée et d’un système de recrutement assez contestable.
Sur le premier point,
notre
gouvernance est
extrêmement lourde et inefficace. Par
exemple on trouve un président, deux
vice-présidents (C’est peut
être même pas suffisant)
avec les services
cen- traux de la présidence
(secrétariat général,
économie, ressources
humaines etc...).
On re- trouve
aussi le même schéma au niveau de chaque établissement, doyen ou directeur,
deux vices,
un économe un chef de personnel,
un chef de scolarité etc.....Rien que
ces équipes et leurs coûts handicapent le budget de l’université et son efficacité.
Pourquoi ne pouvons nous pas avoir un seul service économique
efficace qui gérera
toute l’université ? Pourquoi ne pourrions
nous pas non plus avoir un service
central de la recherche
scientifique avec un vice président et des commissions par discipline
? Pourquoi
avons nous besoin de plusieurs vice directeurs
ou vice-doyens des affaires pédagogiques alors que c’est quelque chose qui peut être harmonisé
au niveau central ? Quelle différence et qu’ est ce qui la justifie
pour avoir plusieurs centres d’études doctorales
au sein d’une même université ? Pourquoi
et
qu’ est ce qui justifie
l’existence de plusieurs
vaguemestres..et
bien d’autres
choses
Concernant le recrutement, il
est vrai que le ministère, par souci d’égalité de chances a instauré
le concours de recrutement des enseignants chercheurs
avec des règles et des commissions sauf que, en instaurant ces commissions on est tombé
involontairement dans un piège : Celui qui a encadré un candidat ou celui qui a été dans le jury d’un candidat, ne peut siéger. Ceci semble logique, neutre et même louable
! Sauf que l’enseignant chercheur
fait sa carrière en encadrant, en
étant dans des jurys, etc...et c’est
un moyen de mesure
de son activité scientifique. Il faut alors demander
à ceux, qui ne sont pas dans la spécialité, ou
ceux qui ne sont pas les jury
de décider
au niveau du recrutement alors même qu’un enseignant chercheur doit être recruté
non seulement pour sa capacité à intégrer
une équipe pédagogique mais aussi pour intégrer une équipe de recherche et y participer. De
ce fait les équipes actives au sein de l’établissement n’auront aucun
regard
sur ce recrutement alors même
que ce sont elles les animatrices et
doivent décider des besoins !
En France, dont on s’inspire
le plus souvent, la commission étant constituée, un
repré- sentant du laboratoire concerné peut y siéger et même en tant que président et peu importe s’il était
ou pas encadrant et
membre de jury, car les autres
membres jouent
pleinement leurs rôles. Cette
erreur vient du fait qu’on dissocie le travail
de l’enseignant chercheur de sa recherche, alors qu’ils sont étroitement liés. En effet que peut faire un chercheur lorsqu’il
est recruté dans un environnement qui ne lui est pas favorable ? Il faut
qu’il redémarre à zéro ses activités ou qu’il erre tout seul
jusqu’à ce qu’il se fatigue
ou qu’une autre issue
s’offre à lui. Alors que le sens même du recrutement devrait favoriser les équipes qui existent et
soutenir les activités de recherche qui existent sur place et éviter la dispersion des énergies pour constituer le
quorum requis
pour une efficacité et une production
optimales.
Dans notre cas, on constitue des équipes hétérogènes, les laboratoires de recherche forment des jeunes sans pour autant pouvoir les intégrer
dans leurs équipes et aller de l’avant.
Ils restent donc toujours affaiblis en ressources humaines
et doivent gérer des situations dif-
ficiles. Dans tous les laboratoires
du monde, qui sont dignes de ce nom et qui participent à la compétitivité
des établissements universitaires, on se bat pour recruter
les jeunes
for- més dans les équipes, qui sont capables de perpétuer la recherche et de mener plus loin les projets
de recherche et de développement.
Il est vrai que notre système universitaire
met la recherche au second plan et se préoccupe plus de l’enseignement mais nos décideurs universitaires n’ont pas intégré la donne unique et universelle : Il n’ y a pas de filière d’enseignement qui réussisse
sans recherche scientifique
en parallèle. Autrement dit : on ne peut
pas exceller dans une filière
si une recherche ne la
soutient pas. En effet nous ne sommes
plus dans les lycées où les programmes sont dictés par le ministère,
nous sommes dans
le domaine de la réflexion
et du développement, de
l’invention et de la course à l’excellence et à l’originalité, de l’invention des métiers du futur et de la société de demain etc....C’est
ce qui se passe dans d’autres universités du monde et qui sont sur les premiers
rangs
Entre l’indépendance
des universités et la gestion
des établissements on
se retrouve dans des situations, pour le moins délicates et parfois honteuses
tellement le sens des responsa- bilités
nous manque : Imaginons
qu’au sein d’une même université, on paye
des millions d’heures supplémentaires à des enseignants qui n’arrivent pas (par manque d’effectifs) à faire leur service au sein de leurs établissements ! ! ! Alors que la loi est claire
à ce niveau. Comment peut on payer des heures
supplémentaires au sein d’une même université,
ou d’un même établissement alors qu’on dispose de ressources pour les faire
gratuitement dans les départements ou établissements voisins
(dans la même université)
? comment permettre de faire enseigner
des matières assignées à d’autres départements au sein d’autres pour les payer ensuite
en vacations ou heures supplémentaires
? C’est tout simplement dépenser d’une ma- nière
inefficace les deniers
publics et gérer
des situations, certes difficiles, uniquement pour faire régner
le calme mais sans courage.
Il est temps de se rendre compte que notre système
universitaire est en panne, complè- tement en
panne. Il génère des situations inédites mondialement, totalement incompréhen-
sibles et inexplicables. Imaginons qu’avec le nombre
de réformes
et de textes modificatifs qu’a connu le statut des enseignants
chercheurs
depuis
la loi 00.1, l’Université
marocaine regorge d’enseignants chercheurs habilités
et pour lesquels on est actuellement en train de préparer
les modalités de passage au corps de professeurs. Le Maroc, sera le seul pays où on peut être habilité à diriger la recherche sans avoir dirigé aucune thèse, il suffit dans certains cas d’avoir un article
scientifique
aussi léger soit–il
et quelques travaux pédagogiques pour être habilité.
Pire
encore,
le Maroc est le seul pays
où on peut atteindre par le passage exceptionnel, le plus haut
grade des professeurs dans le pays, sans avoir rien fait au niveau
de la recherche, ni encadré
un jeune, ni même avoir songé à le faire. Ce sont ces
gens là qui demain aideront à sélectionner
les doyens,
les Présidents et
au
besoin rencontrer les
professeurs de renommée internationale qui viennent visiter notre cher pays et discuter
de projets
de développement.
Pour moi le manque de courage politique et scientifique
nous pousse vers des situations
rocambolesques et notre université
ou plutôt notre
pays nous impose l’inverse et une remise en
cause perpétuelle. Comment en effet
décréter que
20% d’une catégorie
de professeurs doivent être
promus en exceptionnel
et
en rapide, par établissements alors que d’autres enseignants plus
méritants restent bloqués dans d’autres établissements ? au nom de quoi un enseignant à Fès, pourra dépasser celui qui l’a formé mais qui travaille à Rabat ou à Marrakech,
ou alors l’inverse ? Le ministère s’est ravisé une fois pour bannir de la promotion
toutes les activités culturelles, il pourrait aussi faire la même chose pour ces 20% et dire tout simplement
que ce n’est pas automatique et que pour être promu, il faut montrer
ses mérites
et peut être même devant ses pairs.
On se retrouvera alors avec des établissements qui tirent vers l’excellence et une concurrence loyale s’installera et le classement des établissements
s’en ressentira.
La situation restant inchangée, on se retrouve
alors
dans
une
hiérarchie de grade
par ville
: Le Professeur grade B à Rabat est plus méritant que celui de Fès, ou celui
de Marrakech l’est plus que celui d’Agadir etc...Une hiérarchie par
ville et la même chose sera vue au niveau des diplômes. Cette situation voulue par les
syndicats et adoptées par les
collègues, n’a pas été bien étudiée au préalable.
Les autorités sont à mon avis pleinement
conscientes de ces situations et
c’est peut être là une des causes qui fait que l’enseignement privé
se développe au vu et au su
de tout le monde pour
laisser
pourrir et mourir cet enseignement supérieur
public qui ne génère
que plus d’injustices, plus d’inégalités et plus de médiocrité...que d’excellence, d’égalité des chances et de justice qu’il était censé
amener. On s’offusque parfois de
ne voir aucun établissement dans le top 1000
ou top 2000 du classement mondial,
c’est tout simplement parce que la pyramide est inversée
dans notre pays, on a plus de professeurs d’enseignements supérieurs que de professeurs assistants ou
de professeurs habilités, ces deux dernières catégories censées créer la dynamique, pousser à la créativité, à l’innovation et au développement du mérite en concordance
avec leurs collègues professeurs.
Un énorme désordre
a été créé avec la gestion du dossier
du doctorat français, là aussi le courage politique et l’honnêteté scientifique ont fait défaut, on a accordé
des avantages sur
lesquels on est revenu,
et certains de nos collègues
ont bénéficié de trois ans par ci, de six ans par là, et encore une restitution de trois
autres et une récompense
par trois
nouvelles et à la fin ils sont en haut de l’échelle sans avoir fourni
aucun effort, et je dis bien aucun effort. J’exagère peut être un petit peu mais c’est une réalité qui blesse et qui démotive.
Il faut juste ne pas crier que l’enseignement supérieur marocain
est de qualité,
la qualité
doit être son leitmotive
et pour
cela il faut
oser les vérités qui
dérangent, dont quelques unes sont :
– Un enseignant chercheur, est d’abord chercheur, et toute évaluation
ou promotion doit tenir compte de ses activités de recherches. Si les moyens font parfois
défaut, les moyens informatiques
pour une recherche fondamentale existent, les outils informatiques libres
existent et un minimum d’effort
sera reconnu par des pairs et des experts internationaux
reconnus. C’est
me semble-t-il la voie que choisit le CNRST
pour
évaluer les projets
scientifiques
– Bannir l’automaticité des 20% des promotions et laisser la concurrence au niveau na- tional, en mettant 20% au niveau national,
pour promouvoir la qualité et soutenir
les
politiques et les établissements qui avancent et progressent
– Dire que pour pour accéder à un certain grade,
il faut au moins avoir encadré une ou deux thèses, pour encourager la formation
des jeunes
chercheurs, la relève de demain, conserver et
fructifier le savoir faire de nos enseignants
chercheurs,
qu’ils ont acquis parfois avec de lourds sacrifices.
– A l’heure
où on parle de la classe
D, il faut dire
que pour y prétendre, il faut non seulement un dossier,
mais il faut
le défendre devant
ses pairs, voir des experts, car si ce grade vise à distinguer les méritants de nos collègues, il faut
que ceux-ci
soient capables
de défendre leurs dossiers et leurs travaux devant des experts et non seulement
au niveau local, mais au niveau national,
pour une vraie reconnaissance, sinon on re- hiérarchisera encore
une fois la classe D par ville.
De plus lorsqu’on
passe un oral, on saura
en faire passer et la qualité s’en ressentira.
– Faire en
sorte que l’université
marocaine participe à la concurrence mondiale sans aucune
gêne et sans aucune honte.
C’est ainsi que
j’ai essayé de soulever
quelques
points
qui
me semblent importants à améliorer pour que notre système universitaire évolue dans le bon sens et exerce son rôle dans le développement du
pays. Il est vrai que les gestionnaires ont un point de vue qui évoque d’autres
discordes
et
difficultés, qui peuvent se justifier, mais ils nous appartient
à nous tous d’ouvrir le débat,
clairement, calmement sans aucune référence partisane, de poser les jalons
d’un renouveau
et
d’un bon départ, le but ultime étant de trouver une meilleure
issue et un excellent consensus pour notre système universitaire, qui est entre
autre un système de cohésion nationale.
Pr. A. AHAITOUF FST de Fès






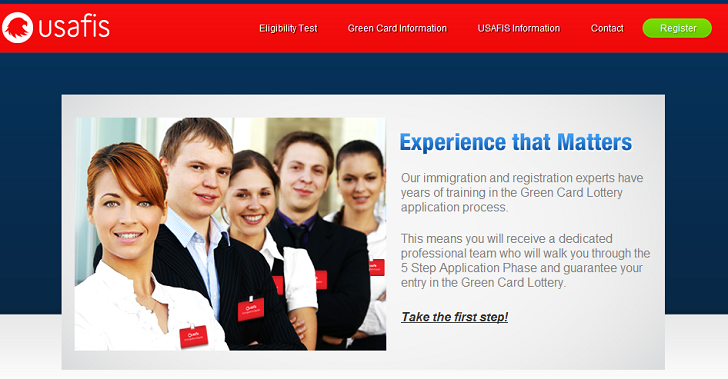





























0 التعليقات: